« Tu me creuses une tombe, moi je trace un chemin de paix »
Lorsque je suis rentrée au Rwanda en janvier 2010, c’était avec une volonté profonde : contribuer à la reconstruction de notre nation meurtrie, main dans la main avec mes concitoyens. Mon rêve était simple mais ambitieux : bâtir un Rwanda fondé sur la liberté d’expression, l’égalité des droits et la cohabitation pacifique des idées. Un Rwanda où personne ne serait laissé pour compte.
Je ne venais pas mendier quoi que ce soit. J’étais une jeune femme accomplie, diplômée en droit des affaires et en investissement, dotée d’une carrière prometteuse et d’une famille aimante. Mais rien de tout cela ne comptait davantage que l’amour inconditionnel que je portais, et que je porte toujours à mon peuple.
Dès mon arrivée, les avertissements n’ont pas tardé. « Ce régime, tu ne le connais pas, il te brisera », me soufflait-on. On me prédisait la prison, voire la mort. Mais j’avais foi. Foi en la puissance des idées, foi en un dialogue sincère, foi en la possibilité d’une démocratie véritable. Si mes convictions devaient me valoir l’exclusion ou la répression, alors j’aurais au moins tenté, avec dignité, de faire ma part. Le reste, je le laissai à l’histoire et aux générations futures.
Hélas, les prophéties de mes détracteurs se sont réalisées. J’ai été persécutée, emprisonnée, faussement accusée d’actes graves. On m’a associée à des groupes rebelles pour mieux justifier mon incarcération. Mais ce que mes bourreaux ignoraient, c’est qu’on peut briser un corps, mais jamais une pensée fondée sur la conscience et la vérité. Les idées, elles, ne se fusillent pas. Elles ne se bâillonnent pas.
Ceux qui ont suivi mon engagement depuis cette date savent que je n’ai cessé de plaider pour un Rwanda plus juste, où les débats contradictoires ont leur place. À chaque tentative de me présenter devant le suffrage universel, les autorités m’ont bloquée, érigeant des barrières toujours plus absurdes.
Pourtant, jamais je n’ai nourri de haine envers le président Kagame ou sa famille. Lui comme moi sommes aujourd’hui grands-parents. Je ressens une joie sincère à le voir entouré de ses petits-enfants, c’est un bonheur universel. Même si l’on m’a refusé le droit de rendre visite aux miens, et surtout à mon mari très malade, j’ai pu au moins embrasser mes enfants et petits enfants. Pour cela, je suis reconnaissante.
On m’a reproché de critiquer certaines politiques gouvernementales. Mais toute démocratie digne de ce nom vit de la critique constructive. Je ne me suis jamais contentée de dénoncer : j’ai aussi salué les avancées. Dans un entretien accordé au Guardian en 2024, j’ai reconnu les efforts du président Kagame dans le développement économique du pays. J’ai simplement rappelé que ce progrès serait plus complet avec une ouverture réelle de l’espace politique.
En 2018, j’ai été graciée. J’avais salué ce geste du chef de l’État, espérant qu’il marquerait le début d’un dialogue inclusif. Avec d’autres Rwandais, j’ai tenté de montrer que la stabilité régionale commence par un dialogue sincère au sein de nos propres frontières.
Mais, récemment, la violence à mon égard a pris une nouvelle tournure. Les 6, 9 et 13 juillet 2024, le président Kagame m’a publiquement attaquée. Il a déclaré que nous n’atteindrions jamais rien avant de mourir. Il m’a traitée de « petite femme d’un génocidaire », et m’a accusée de liens avec les fauteurs de troubles dans l’Est de la RDC. Puis il a ajouté que je finirais mal.
Comme souvent, les attaques venues d’en haut se répandent comme une traînée de poudre. Des internautes se sont déchaînés, certains appelant à mon exécution en pleine rue. Fait troublant : le Bureau rwandais d’investigation (RIB) n’a engagé aucune poursuite contre eux, alors que des journalistes sont arrêtés pour de simples propos publiés en ligne.
Aujourd’hui, me voilà de nouveau incarcérée à la prison de Mageragere, comme l’avait publiquement promis le président Kagame en septembre 2018, devant une assemblée de députés conquis. Cette fois-ci, l’on m’accuse d’avoir encouragé un groupe de personnes à lire un ouvrage consacré aux stratégies de résistance pacifique face aux régimes autoritaires. Une accusation dont l’absurdité ne masque pas la gravité.
Tragiquement, cette situation ravive un précédent lourd de sens : celui du chanteur et militant Kizito Mihigo. Lui et moi avons partagé la même prison, à la même époque. Son « crime » ? Avoir composé une chanson prônant l’amour, le pardon et le respect égal de toutes les victimes du conflit rwandais, au-delà des appartenances ethniques.
Comme moi, il avait bénéficié d’une grâce présidentielle. Mais peu après, il fut de nouveau arrêté et cette fois, il n’en est jamais ressorti vivant. Il a été retrouvé mort dans sa cellule de police, dans des circonstances jamais élucidées. Son message d’amour universel et de réconciliation aura suffi pour qu’il soit perçu comme une menace.
Aujourd’hui, je sais que mon sort pourrait lui ressembler. Car dans le langage codé du FPR, il est commun d’affirmer qu’on ne « réincarcère pas deux fois » manière cynique de dire que les anciens prisonniers n’ont pas droit à une seconde chance : ils disparaissent. C’est cette ombre qui plane désormais sur moi.
Et pourtant, tant qu’il me reste un souffle de vie, je continuerai à porter ce message. À mes compatriotes du Rwanda, à nos voisins, à toutes les nations éprises de paix : je n’ai pour toute arme que mes idées, et pour seule force que l’amour profond que je ressens pour le peuple rwandais. Je n’ai jamais tenu une arme, et je n’en tiendrai jamais. Mon engagement est celui de la paix, du respect mutuel, du dialogue et de la démocratie.
Au président Kagame, je dis ceci : tout ce que vous avez entrepris contre moi ne pourra jamais effacer l’amour sincère que je ressens, y compris pour vous. Je vous garde dans mes prières chaque jour, demandant à Dieu de vous éclairer, car je n’ai rien d’autre à offrir que cette espérance.
Alors, même si vous me creusez une tombe, moi, je continuerai à paver un chemin de paix. Un chemin que fouleront, un jour, les Rwandais d’aujourd’hui et de demain.
Axel Kalinijabo
Vous pourriez être intéressé(e)

Rwanda 2026 : l’après-Kagame, une bombe à retardement pour l’Occident
Emmanuel Neretse - 1 janvier 2026En ce début d'année 2026, Paul Kagame entame sa 32è année de règne sans partage sur le Rwanda. Mais certains prévoient et se préparent à sa fin,…

Victoire Ingabire: Chronicle of an Announced Political Repression
Vestine Mukanoheri - 25 décembre 2025The trajectory of Victoire Ingabire Umuhoza, a leading figure of the Rwandan opposition, is one of the most emblematic examples of political repression in Paul Kagame’s Rwanda.…

Victoire Ingabire : chronique d’une répression politique annoncée
Vestine Mukanoheri - 22 décembre 2025Le parcours de Victoire Ingabire Umuhoza, figure majeure de l’opposition rwandaise, est l’un des exemples les plus emblématiques de la répression politique au Rwanda de Paul Kagame.…
Les plus populaires de cette catégorie

RDC-Rwanda : l’heure des sanctions contre le régime Kagame a sonné
Emmanuel Neretse - 21 décembre 2025
Le Rwanda et les conflits cycliques issus de la culture de l’impunité dans les grands lacs
Laurent Munyandilikirwa - 15 décembre 2025
Accords de Washington : Trump face à l’épreuve de la paix au Congo
Vestine Mukanoheri - 12 décembre 2025













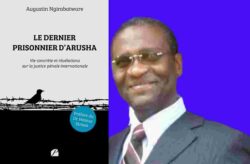
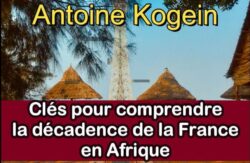





![Paul Kagame a fait main basse sur le commerce juteux de la friperie et sur la culture et la vente du cannabis [Série 8]](https://www.echosdafrique.com/wp-content/uploads/2021/07/cannabis-Kagme_Marijuana-250x161.jpg)












