Le Rwanda face à lui-même : Avons-nous réellement compris nos problèmes ?
Depuis plusieurs années, j’observe et j’écris sur les problèmes de notre société rwandaise. Chaque fois, je tente d’analyser les faits et de proposer des pistes de solution, convaincu que notre salut réside dans la réflexion collective et l’action constructive. Mais aujourd’hui, une question plus fondamentale me hante : et si notre véritable problème était de ne pas savoir identifier nos problèmes ?
Une perception fragmentée de la réalité
J’ai écouté avec attention de nombreux Rwandais, de divers horizons, exprimer leur compréhension des enjeux du pays. Les divergences d’analyse sont flagrantes, chacun décrivant la réalité à travers sa propre expérience, son idéologie, ou sa position sociale. Moi-même, je me suis surpris à penser que ma vision était la plus lucide, jusqu’à me demander : Avons-nous réellement saisi l’essence de ce qui nous empêche d’avancer ?
Plutôt que d’imposer une réponse, je vous propose une introspection partagée. Parmi les défis suivants, lequel considéreriez-vous comme le plus urgent à résoudre au Rwanda ?
Les tensions ethniques persistantes
L’avidité de pouvoir chez nos dirigeants
Le népotisme et la corruption dans l’accès à l’emploi
Le non-respect des droits humains
L’absence d’indépendance de la justice
Le rétrécissement de l’espace politique
Les inégalités économiques grandissantes
Le rôle de l’armée dans la politique
L’instrumentalisation des religions
La manipulation du souvenir historique
Vous pourriez en citer bien d’autres. Mais à mon sens, le fond du problème réside ailleurs : dans le manque de volonté politique et de courage collectif pour engager un véritable dialogue national. Un dialogue honnête, transparent, inclusif – qui ne cherche pas à désigner des ennemis, mais à construire un avenir commun.
Une volonté politique à sens unique
Le Rwanda a connu par le passé quelques élans de volonté politique. Mais souvent, cette volonté a été au service du pouvoir, non du peuple. Depuis 1994, le régime de Paul Kagame a construit un système politique rigide, centralisé, où toute voix dissonante est considérée comme une menace. Ceux qui dépassent la « ligne rouge » – dont seul Kagame connaît les contours – sont réduits au silence, emprisonnés ou éliminés.
Ce qui est encore plus alarmant, c’est que cette dérive autoritaire est acceptée, voire justifiée, par une partie de la population, comme un mal nécessaire à la stabilité. C’est là une forme de normalisation de l’inacceptable qui devrait tous nous interpeller.
Un peuple fragmenté et désorienté
Il ne fait aucun doute que Kagame a poursuivi une vision claire, avec une discipline stratégique rare : il savait ce qu’il voulait, comment l’obtenir, et comment écarter ceux qui s’y opposaient. Sur ce plan, il a réussi.
Mais en face, qu’en est-il du reste des Rwandais ? Nous avons été désorganisés, divisés, souvent passifs. Ceux qui soutiennent le régime vivent dans l’illusion d’être protégés. Ceux qui s’y opposent sont marginalisés ou dispersés. Pourtant, les conséquences du système actuel finiront par toucher tout le monde, car aucune dictature n’est éternelle, et les fractures qu’elle crée laissent des cicatrices durables.
Un appel à la conscience nationale
Nous ne pouvons pas prétendre aimer notre pays sans dénoncer ce qui nous détruit en silence. Il est temps de se lever et de dire haut et fort :
“Nous voulons la paix. Nous rejetons l’injustice. Nous exigeons d’avoir droit au chapitre dans les affaires de notre pays. Nous condamnons la torture et la terreur politique.”
Ce combat ne peut pas être laissé à quelques-uns. Il nous concerne tous, chaque jour.
Le piège de la violence
Certains, aujourd’hui, pensent que l’heure du dialogue est dépassée, que seule la force peut faire tomber le régime. Je les mets en garde : la guerre ne résout pas nos problèmes, elle les aggrave. Ceux qui l’ont vécue savent à quel point elle détruit tout : vies humaines, cohésion sociale, tissu économique, espoir.
Si la guerre était une solution, nous vivrions aujourd’hui dans une nation apaisée, réconciliée, prospère, car les guerres on en a eu par milliers et de tous genre. Or, le Rwanda actuel reste marqué par la peur, la méfiance, et le silence imposé.
Conclusion : Qui sommes-nous devenus ?
Alors je vous pose la question : quel peuple sommes-nous devenus ?
Un peuple résigné ou un peuple debout ?
Un peuple prisonnier de son passé ou prêt à écrire une nouvelle page de son histoire ?
Le temps d’agir est aujourd’hui, ne le gaspillons pas.
Axel Kalinijabo
Vous pourriez être intéressé(e)

L’idéologie du génocide au Rwanda : une loi discriminatoire
Athanase Dushimirimana - 14 septembre 2025Introduction Il y a beaucoup d’éléments qui caractérisent une loi mais l'essentiel que je voudrais ici présentement souligner c’est qu'une loi ne doit pas discriminer. La…

Le transfert de Félicien KABUGA (90 ans) vers le Rwanda n’est pas justifié en droit
Innocent Twagiramungu - 12 septembre 2025L’affaire relative à M. Félicien Kabuga, considéré comme l’un des principaux organisateurs du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994, soulève d’importantes questions de droit…

Maxime Prévot au Rwanda en novembre : real politik ou « aller à Canossa »?
Valentin Akayezu - 12 septembre 2025Ci-après deux textes, deux avis sur le voyage prévu en novembre au Rwanda par Maxime Prévot, ministres belge des Affaires étrangères. Maxime Prévot à Kigali :…
Les plus populaires de cette catégorie

Migrants contre devises : le marché honteux entre Washington et Kigali
Echos d'Afrique - 10 septembre 2025
Paix et stabilité dans la région des Grands Lacs d’Afrique – Série 1
Emmanuel Neretse - 9 septembre 2025
Le tribunal pénal international pour le Rwanda d’Arusha n’a pas accompli son mandat
Athanase Dushimirimana - 3 septembre 2025












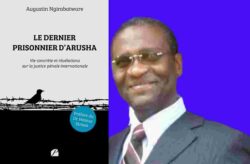
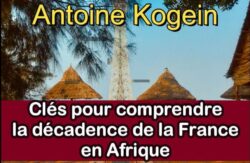
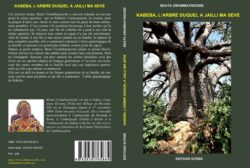





![Paul Kagame a fait main basse sur le commerce juteux de la friperie et sur la culture et la vente du cannabis [Série 8]](https://www.echosdafrique.com/wp-content/uploads/2021/07/cannabis-Kagme_Marijuana-250x161.jpg)












