Le pouvoir judiciaire au Rwanda : une arme du pouvoir exécutif pour opprimer ses opposants
- Introduction
Lorsqu’ils statuent sur une affaire, les juges doivent accomplir une tâche difficile de bien comprendre le droit applicable. Quand les juges ont bien compris le droit ils doivent également comprendre la nature de l’affaire. Ils doivent comprendre clairement la position des parties et examiner attentivement et avec une grande perspicacité les preuves présentées par les parties avant de rendre leurs décisions. Dans l’exercice de cette fonction, les juges de nombreux pays sont souvent confrontés au problème des instructions et intimidations du pouvoir exécutif. Si les juges les ignorent, ils sont souvent persécutés et leur vie devient difficile. Clairement, la magistrature n’est pas libre et impartiale dans quelques systèmes du monde.
Dans tous les pays du monde, des lois constitutionnelles régissent la structure et le fonctionnement des trois pouvoirs du gouvernement: le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Aujourd’hui, des médias et des groupes de personnes indépendantes qui luttent pour le respect des droits de l’homme s’ajoutent sur ces trois pouvoirs pour permettre au peuple de s’informer et de crier à haute voix en cas de grave violation des libertés fondamentales de l’homme.
- La suprématie du pouvoir judiciaire
En général, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont indépendants, chaque pouvoir est indépendant et distinct des autres. Cette indépendance est un principe inscrit dans la Constitution qui détermine la structure et le fonctionnement de chaque pouvoir. Ce principe est appelé « séparation et indépendance des trois pouvoirs ». Pendant le Siècle des Lumières, des juristes et philosophes comme John Locke et Jean Jacques Rousseau ont conclu que le roi détenait tous les pouvoirs: il faisait des lois, il exécutait des lois et il les appliquait en jugeant des contrevenants. Des érudits de l’époque comme John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu et d’autres ont conclu que la monarchie était injuste envers le peuple en raison de son accumulation de pouvoir. Ces érudits ont donc écrit divers ouvrages prônant la séparation de ces pouvoirs et leur indépendance.
Aujourd’hui, lorsque nous examinons le point concernant la complémentarité de ces trois pouvoirs (la collaboration des trois pouvoirs), nous constatons que ce principe d’indépendance de chaque pouvoir pourrait constituer un obstacle au bon fonctionnement du pays. Donc, ce principe d’indépendance et de la séparation doit permettre la complémentarité des activités des trois pouvoirs. Par exemple : le pouvoir exécutif prépare le budget national, le pouvoir législatif adopte les lois régissant ce budget et le pouvoir judiciaire sanctionne les dirigeants qui abusent de son affectation et son utilisation. En général, pour que chaque pouvoir puisse remplir sa mission il a besoin d’un autre pouvoir pour le compléter (le principe de la collaboration des trois pouvoirs).
Si l’on examine attentivement la complémentarité de ces trois pouvoirs l’on constate que le pouvoir judiciaire est supérieur aux autres. Tous ces pouvoirs sont unis par le terme “loi”. Le pouvoir législatif édicte les lois, le pouvoir exécutif les applique et le pouvoir judiciaire sanctionne ceux qui les enfreignent.
Le pouvoir judiciaire, chargé de sanctionner les contrevenants, vérifie que des décisions du pouvoir exécutif sont conformes aux lois. Si les juges constatent qu’une décision prise par des dirigeants du pouvoir exécutif contredit une loi ils l’annulent et la déclarent invalide. Il est donc clair que le pouvoir judiciaire est supérieur au pouvoir exécutif.
Avant qu’une loi puisse être appliquée par tous les citoyens du pays elle doit être votée par des députés et elle doit être soumise à la Cour Suprême afin de déterminer si elle viole la Constitution et les autres lois du pays. Si cette cour estime que la loi viole des principes fondamentaux du pays, elle la renvoie au pouvoir législatif ou au chef de l’État afin qu’ils la corrigent. De ce point de vue, on peut dire que le pouvoir judiciaire est supérieur au pouvoir exécutif.
- Indépendance du pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire est indépendant. Ce principe d’indépendance des juges est inscrit dans la Constitution et dans de nombreux autres textes internationaux. Les États membres des Nations Unies, dans leurs résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146, ont constaté que les droits de l’homme n’étaient pas respectés dans de nombreux pays en raison du nombre important de détenus incarcérés pendant de longues périodes sans jugement. Ils ont ainsi conclu que tout accusé, même accusé de crimes graves, a les droits suivants: l’égalité devant la loi, la présomption d’innocence et le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Afin de garantir le respect de ces droits fondamentaux de l’accusé, le septième Congrès des Nations Unies, tenu du 26 août au 6 septembre 1985 à Milan, a examiné le problème de la criminalité et du traitement des criminels et a adopté à l’unanimité le principe de l’indépendance des magistrats. Dans son article 5, le Congrès a confirmé que l’indépendance des juges devait être inscrite dans la Constitution de chaque pays. Le quatrième article stipule que le juge doit exercer ses fonctions sans aucune pression.
Par ailleurs, le travail du juge vise à rendre justice aux citoyens afin que leurs droits fondamentaux soient respectés. Le juge s’acquitte de cette tâche en s’appuyant sur divers textes juridiques, mais il doit également faire appel à sa conscience. Il use de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il est confronté à la question qu’il doit résoudre et qu’aucune loi ne la prévoit. Il examine attentivement des preuves présentées par des parties afin de rendre sa décision. La décision du juge devient loi lorsque le délai d’appel est expiré et qu’aucun appel n’a été interjeté ou lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées. Compte tenu de l’importance de la mission du juge, la loi lui garantit une indépendance totale pour exercer ses fonctions sans crainte ni intimidation.
Dans les pays autoritaires, l’indépendance des juges est limitée. Il est clair que très souvent le pouvoir exécutif fait appel à des juges pour obtenir la condamnation de quiconque ose critiquer le gouvernement. Par conséquent, des juges sont souvent nommés de manière à ce que le pouvoir exécutif joue un rôle important. Les juges sont également promus ou récompensés par l’exécutif. Dans les pays autoritaires, des juges ne sont pas indépendants et doivent juger suivant des instruction du pouvoir exécutif.
- La justice rwandaise au cœur de la fabrication de crimes pour la condamnation d’innocents
Dans les pays autoritaires, l’indépendance des juges est limitée. Il est clair que très souvent le pouvoir exécutif fait appel à des juges pour obtenir la condamnation de quiconque ose critiquer le gouvernement. Par conséquent, des juges sont souvent nommés de manière à ce que le pouvoir exécutif joue un rôle important. Les juges sont également promus ou récompensés par l’exécutif. Dans les pays autoritaires, des juges ne sont pas indépendants et doivent juger suivant des instruction du pouvoir exécutif.
Lorsque nous parlons de la magistrature nous voulons renvoyer à la magistrature debout et à la magistrature assise. La magistrature debout est composée des organes chargés de poursuivre des crimes, de rechercher des preuves des crimes commis et de traduire en justice des personnes soupçonnées d’avoir commis ces crimes. La magistrature assise est chargée d’examiner des dossiers soumis par la magistrature debout pour rendre des jugements qui déclarent des accusés coupables ou innocents.
Au Rwanda, la magistrature debout et la magistrature assise sont toutes deux des organes des forces de l’ordre. Une analyse approfondie révèle que la justice rwandaise vise à protéger des intérêts des membres d’un groupe de personnes appartenant au FPR.
Une simple observation démontre que le système judiciaire rwandais est dominé par les Tutsis. Au Rwanda, les meilleurs postes sont occupés par des Tutsis travaillant pour le FPR. Au Rwanda, tous les postes importants de direction tant au sein des institutions gouvernementales que privées, tant au sein de l’armée qu’au sein des autres agences de sécurité sont occupés par les Tutsis. Les Hutu et les Batwa sont victimes de discrimination dans la gouvernance du pays. Cette discrimination se retrouve également dans le système judiciaire. Dans la magistrature, les Tutsis sont nommés sans considération de leurs compétences, mais ils sont sélectionnés en fonction de leur appartenance ethnique et la plupart d’entre eux sont des membres ayant prêté allégeance au FPR en secret. Les Hutus sont peu nombreux dans le système judiciaire et n’occupent pas de postes importants. De ce fait, des affaires sont jugées selon des instructions strictes des hauts dirigeants du FPR, et la plupart d’entre eux sont des Tutsis.
Il est à remarquer que tous les crimes commis doivent être poursuivis par des procureurs, et la plupart d’entre eux sont des Tutsis travaillant pour le compte de FPR. Pour cette raison, ces procureurs doivent sauvegarder des intérêts du FPR. Prenons un exemple: des crimes commis contre des réfugiés à Kibeho ont été commis par des soldats du FPR, et beaucoup d’entre eux sont libres parmi nous. Aucune loi n’empêche le parquet d’enquêter sur ces crimes, mais personne n’oserait convoquer le général Fred Ibingira pour l’interroger, car il figurerait parmi des personnes soupçonnées d’avoir massacré ces réfugiés. Il s’avère qu’aucun soldat du FPR qui a commis des crimes contre des Hutus ne peut être poursuivi devant des tribunaux car le parquet qui devrait ouvrir des enquêtes travaille pour protéger des membres du FPR. En bref, le parquet devrait servir le FPR et protéger des intérêts des membres de ce groupe.
Faisant référence à Voice of America du 11 octobre 2004, Joseph Matata du Centre de Lutte contre l’Impunité et l’Injustice au Rwanda, dans son communiqué n° 77/2024, dit qu’il y a des syndicats de délateurs au ministère de la Justice. Il dit que la magistrature rwandaise est contrôlée par des chefs militaires et politiques du FPR.
Par conséquent, si vous regardez de plus près, vous constaterez que le parquet est instrumentalisé pour fabriquer des crimes contre ceux que le FPR appelle “ennemis du pays”. C’est dans ce contexte que M. Paul Rusesebagina a été accusé au point d’être enlevé à l’étranger puis rapatrié. Cet acte constitue la violation de l’article premier de la Convention internationale pour la protection de toutes personnes contre des disparitions forcées. Le parquet a joué un rôle majeur dans son enlèvement et son inculpation. L’enlèvement de Rusesabagina est un crime grave commis par le parquet. L’Etat Américain n’a cessé de donner des ordres au Gouvernement rwandais pour la libération de Rusesabagina parce que logiquement selon ses informations il était innocent et n’était emprisonné que sur base de crimes fabriqués. Le parquet est donc instrumentalisé pour fabriquer des crimes contre ceux qui critiquent le régime de Paul Kagame.
Le cas d’Ingabire Victoire a récemment été examiné par le Parlement Européen qui a jugé injuste sa détention et il a ordonné sa libération. Ingabire Victoire a été emprisonnée en 2010 et condamnée par les tribunaux rwandais. Cette courageuse femme politique a interjeté appel devant la Cour Africaine des droits de l’homme à Arusha qui a jugé que les tribunaux rwandais l’avaient condamné injustement. Le Rwanda a ignoré cette décision de la Cour Africaine et a continué de l’emprisonner. Cela signifie que le parquet rwandais a fabriqué les crimes contre elle et que des juges les ont confirmés. Cette injustice envers cette femme politique démontre comment le parquet est instrumentalisé par les hauts dirigeants du pays pour arrêter et emprisonner des politiciens qui critiquent le gouvernement. Ces derniers mois, Victoire Ingabire a de nouveau été victime de crimes inventés par le parquet. Les services de sécurité l’ont de nouveau arrêtée et elle est actuellement détenue à Mageragere. Le parquet invente des crimes contre Victoire Ingabire afin qu’elle ne puisse plus critiquer le gouvernement de Paul Kagame. Ainsi, lorsque ces crimes inventés sont portés devant des juges ils sont confirmés et des innocents sont emprisonnés.
Une fois la fabrication du crime achevée, l’étape suivante consiste à fabriquer des preuves pour condamner un individu. Le ministère public fait comparaître de faux témoins et leur dicte des propos à tenir pour accuser un individu que le gouvernement veut emprisonner. À ce moment-là, le ministère public fabrique d’autres preuves instaurant ainsi une culture du mensonge. Dans ce processus de fabrication de preuves et de témoins le ministère public fait souvent appel à des syndicats de délateurs souvent composés de Tutsis déterminés à fournir de faux témoignages afin d’emprisonner des politiciens hutus innocents. Ces groupes de délateurs ont été largement utilisés lors des procès « gacaca » pour obtenir l’emprisonnement de nombreux Hutus et la confiscation de leurs biens.
Ces groupes de délateurs sont également utilisés pour fournir de faux témoignages aux personnes emprisonnées pour génocide dans les pays européens. Il est regrettable qu’une personne ait été arrêtée par le parquet pour avoir enfreint la directive « Je suis Rwandais ». Cette directive stipule qu’il n’y a pas de groupes ethniques au Rwanda, qu’il n’y a ni Hutus, ni Tutsis, ni Twas, qu’il n’y a que des Rwandais. Affirmer qu’il existe trois groupes ethniques au Rwanda (Twas, Hutus et Tutsis) est un crime considéré comme une forme de haine ethnique.
Quiconque soulève la question de l’appartenance ethnique au Rwanda ou des inégalités ethniques commet un crime grave, le parquet l’arrête immédiatement et l’emprisonne pour idéologie du génocide. Lorsqu’il est présenté aux juges, ceux-ci le déclarent immédiatement coupable et l’emprisonnent. Il est regrettable qu’un juge ignore la vérité qu’il connaît bien et rende un jugement qui emprisonne un innocent. Emprisonner quelqu’un sur base d’un mensonge inventé par le parquet revient à commettre une injustice, c’est confirmer l’absence de la vérité. Des tribunaux qui agissent ainsi sont des tribunaux politiques qui sont au service des politiciens.
- Conclusion
Le système judiciaire rwandais n’est pas ’indépendant et il est contrôlé par le FPR. En bref, les tribunaux rwandais sont des tribunaux politiques chargés de veiller à ce que personne n’ait d’opinions contraires à la ligne du FPR. Le système judiciaire rwandais vise à faire taire ceux qui critiquent le régime de Paul Kagame afin que tous les citoyens du pays ignorent des erreurs de gouvernance et la glorifient aveuglement. On peut dire que le système judiciaire rwandais est responsable de juger des affaires sur base des mensonges car il valorise des crimes inventés par les Parquets contre des opposants du régime de Paul Kagame. Les mensonges des Parquets sont cautionnés par les juges qui ordonnent l’emprisonnement de toute personne ayant des opinions contraires à celles du FPR.
On ne se tromperait pas en affirmant que le système judiciaire rwandais vise à cautionner l’injustice que le FPR inflige à ceux qu’il considère comme ses ennemis simplement parce qu’ils critiquent ses actes. En raison de cette injustice infligée par le système judiciaire qui vise à protéger les intérêts des membres de la faction du FPR la réconciliation au Rwanda n’a pas encore été réalisée. Les Hutus craignent constamment qu’un simple et ordinaire langage ethnique se transforme en idéologie génocidaire et que les Parquets les arrêtent et les emprisonnent. Le Parquet constitue une armée vigilante qui est constamment à la recherche de toute personne pouvant concevoir des idées différentes des mensonges que le FPR a inculqués à la population.
Il est temps que le Rwanda réforme le système judiciaire afin de mettre fin à l’injustice qui est le résultat des crimes inventés de toutes pièces par les parquets. Le système judiciaire doit être réformé afin que les citoyens ne soient plus victimes d’injustice imposée par des tribunaux œuvrant politiquement pour le compte des membres de FPR. Les décisions des juges ont un impact considérable sur la vie des citoyens. C’est pourquoi le système judiciaire doit être indépendant et impartial pour sauvegarder des libertés fondamentales de l’homme au Rwanda.
Athanase Dushimirimana
21/09/2025
Vous pourriez être intéressé(e)

L’idéologie du génocide au Rwanda : une loi discriminatoire
Athanase Dushimirimana - 14 septembre 2025Introduction Il y a beaucoup d’éléments qui caractérisent une loi mais l'essentiel que je voudrais ici présentement souligner c’est qu'une loi ne doit pas discriminer. La…

Le transfert de Félicien KABUGA (90 ans) vers le Rwanda n’est pas justifié en droit
Innocent Twagiramungu - 12 septembre 2025L’affaire relative à M. Félicien Kabuga, considéré comme l’un des principaux organisateurs du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994, soulève d’importantes questions de droit…

Maxime Prévot au Rwanda en novembre : real politik ou « aller à Canossa »?
Valentin Akayezu - 12 septembre 2025Ci-après deux textes, deux avis sur le voyage prévu en novembre au Rwanda par Maxime Prévot, ministres belge des Affaires étrangères. Maxime Prévot à Kigali :…
Les plus populaires de cette catégorie

Migrants contre devises : le marché honteux entre Washington et Kigali
Echos d'Afrique - 10 septembre 2025
Paix et stabilité dans la région des Grands Lacs d’Afrique – Série 1
Emmanuel Neretse - 9 septembre 2025
Le tribunal pénal international pour le Rwanda d’Arusha n’a pas accompli son mandat
Athanase Dushimirimana - 3 septembre 2025












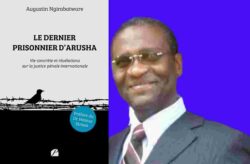
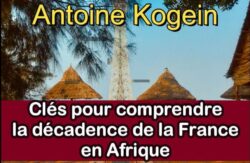
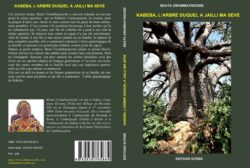





![Paul Kagame a fait main basse sur le commerce juteux de la friperie et sur la culture et la vente du cannabis [Série 8]](http://www.echosdafrique.com/wp-content/uploads/2021/07/cannabis-Kagme_Marijuana-250x161.jpg)













