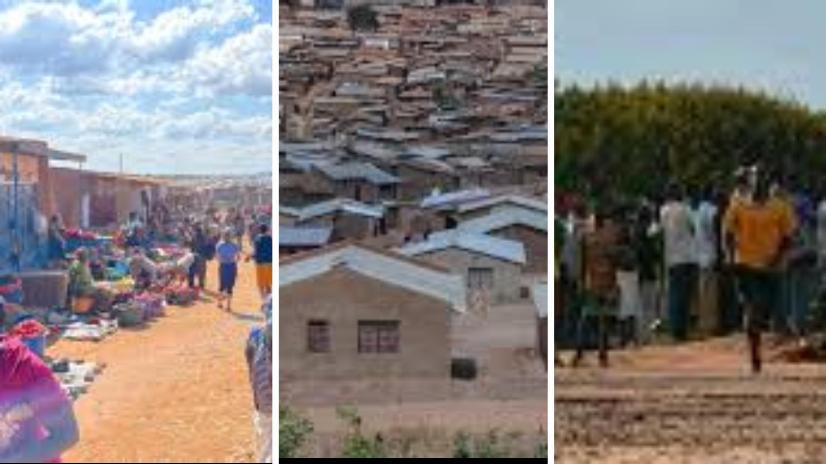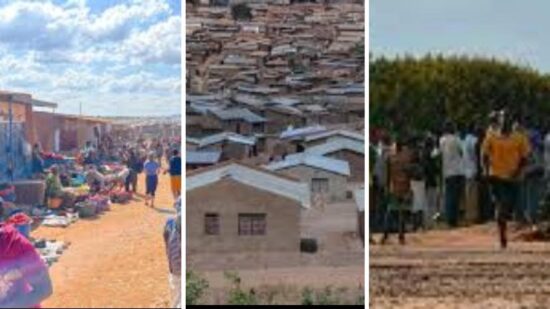La dérogation aux droits fondamentaux des réfugiés au Malawi
- Documents juridiques internationaux consacrés aux droits des réfugiés
La Seconde Guerre Mondiale a poussé d’innombrables personnes à quitter leurs pays pour s’établir à l’étranger. Dès lors, les Nations Unies se sont préoccupées de trouver des moyens de garantir l’hébergement et la satisfaction des besoins élémentaires de ces personnes. En 1951, les Nations Unies ont adopté une Convention qui est historiquement le premier document remarquable définissant et garantissant des droits fondamentaux des réfugiés. Bien que ce document fût limité au continent européen et aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, il a permis au monde entier de prendre conscience de la nécessité de reconnaître et de protéger juridiquement les droits des réfugiés. En 1967, la même Assemblée Générale des Nations Unies a adopté un Protocole additionnel à la Convention de 1951 afin de supprimer les barrières temporelles et territoriales. Ainsi, les droits de l’homme consacrés par la Convention de 1951 ont été étendus et appliqués à toutes les personnes répondant à la définition de réfugié qu’elle avait établie lors de son adoption. Cette définition était principalement centrée sur le « persécution » ; ceci veut dire que toute personne qui se sent persécutée à cause de sa religion, race, sa tribu ou autre stéréotype devrait être protégée comme refugié dans un pays d’accueil qui a l’obligation de ne pas l’expulser vers son pays d’origine. Le principe de non-refoulement est grandement basé sur le fait que la vie humaine est sacrée dans son intégralité ; le fait d’expulser quelqu’un vers un pays où il sera torturé ou persécuté constitue une violation grave de ses droits fondamentaux.
Le droit d’asile devient un des éléments primordiaux que la Convention de 1951 veut souligner et protéger. La Déclaration Universelle de Droits de l’Homme (1948) stipule dans son article 14 que toute personne a droit de chercher l’asile si elle se sent persécutée. Cet article précise que ce droit ne doit pas être évoqué par quelqu’un qui est poursuivi pour un crime commis.
En 1969, l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) a adopté une Convention abordant les problèmes spécifiques du continent africain et soulignant le principe de non-refoulement. Ce principe de non-refoulement était au cœur de deux instruments juridiques des Nations Unies relatifs aux réfugiés. L’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) souligne que toute personne persécutée dans son pays a droit de chercher asile dans un autre pays qui doit la protéger et lui accorder des droits fondamentaux pour son intégration. L’article 2(3) de cette Convention stipule que tout Etat signataire ne doit expulser une personne qui cherche l’asile sur son territoire lorsqu’il y a des raisons de croire qu’elle sera persécutée si elle rentre forcément dans son pays d’origine.
En 2000, le Parlement européen a adopté une Charte des droits fondamentaux pour l’Union européenne. Cette charte était principalement fondée sur le principe de la dignité humaine. Ce document juridique met l’accent sur le droit à la vie, perçu comme le point central de tous les droits individuels. En vertu de l’article 18, cette charte reconnaît les droits fondamentaux des réfugiés tels qu’ils sont consacrés par les Conventions des Nations Unies de 1951 et de 1967. En vertu de cette charte, l’article 19 souligne le principe de non-refoulement comme un pilier central des droits des réfugiés.
En 1981, l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) a adopté une Charte des droits de l’homme et des peuples. L’article 12 (3) reconnaît le droit de demander l’asile au sens de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (1951). L’article 12 (4) de cette charte interdit l’expulsion de tout demandeur d’asile s’il risque d’être persécuté dans son pays d’origine. Ainsi, le principe de non-refoulement consacré par la Convention des Nations Unies de 1951, mentionnée ci-dessus, est reconnu par les pays africains.
- Des réserves du Malawi à la Convention des Nations Unies relative aux réfugiés de 1951
La Convention des Nations Unies relative aux réfugiés de 1951 est le document le plus important, généralement invoqué lorsque la question des droits des réfugiés est évoquée. Cette convention a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à Genève le 28 juillet 1951. Il existe également la Convention et le Protocole relatifs au statut des réfugiés, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1967. En ratifiant ces deux documents, le Malawi a exprimé des réserves importantes concernant certaines sections de la convention de 1951 qui consacrent d’importants droits individuels aux réfugiés. Le gouvernement du Malawi considère ces dispositions comme des recommandations et non comme des obligations juridiques.
La République du Malawi a adhéré à ces documents juridiques le 10 décembre 1987. Le 4 novembre 1987 le Malawi a ratifié la Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. La réserve du Malawi concernant la Convention des Nations Unies relative aux réfugiés (1951) concerne l’article 7 relatif à la réciprocité. Cette réserve concerne l’exemption de réciprocité qui empêche les réfugiés de bénéficier de la même protection juridique que celle accordée aux citoyens. En vertu de l’article 7 de la Convention des Nations Unies relative aux réfugiés, les réfugiés bénéficient du même traitement que les autres étrangers. Dans ce contexte, cette loi vise à protéger les réfugiés dans pays où les droits des citoyens sont inférieurs aux normes internationales. Cet article précise qu’après trois ans de séjour dans un pays d’asile, un réfugié bénéficiera des mêmes droits que ceux reconnus aux étrangers. Ainsi, si les étrangers sont autorisés à exercer une profession libérale, des réfugiés pourront également en bénéficier. Le gouvernement du Malawi a fait une réserve concernant cette disposition.
Le gouvernement du Malawi a fait une réserve concernant l’article 13 de la Convention de 1951 relative aux réfugiés qui porte sur la restriction du droit de propriété. En 2022, le gouvernement du Malawi a promulgué une loi interdisant aux étrangers d’acheter des terres, sauf des investisseurs et des personnes impliquées dans des œuvres caritatives. Cette loi renforce cette réserve dans la mesure où les réfugiés ne sont pas citoyens et ne doivent donc pas acheter de terres. Le droit de propriété a été bafoué au Malawi à chaque fois que des violences ont éclaté contre les réfugiés. En 2015, 2020 et 2023 des maisons de commerce des réfugiés ont été pillées par des citoyens, des policiers et des agents de l’immigration, sans que personne ne soit inquiété. Personne n’a été poursuivi pour son implication dans ces actes criminels.
Le Malawi a également émis une réserve concernant l’article 15 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés qui accorde le droit d’association aux réfugiés. Par dérogation, dans le camp de Dzaleka, certains réfugiés ont formé des associations pour satisfaire leurs aspirations, notamment dans le secteur agricole. Au Malawi, les réfugiés ne doivent pas faire part des activités typiquement politiques.
Le Gouvernement du Malawi a également fait une réserve concernant l’article 17, qui porte sur la question de l’emploi salarié. En effet, certains réfugiés exercent des activités artisanales et tiennent des boutiques en zones urbaines, même si, en cas de violence, ils sont victimes de pillage sans merci. Certains réfugiés travaillent dans l’agriculture autour du camp de Dzaleka et personne ne les sanctionne en raison de leur statut.
L’article 19 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés accorde le droit à l’éducation aux réfugiés. L’article 25 de la Constitution de la République de Malawi accorde ce droit d’éducation élémentaire aux citoyens. Le Gouvernement du Malawi a émis une réserve concernant ce droit pour des réfugiés, bien qu’en pratique, aucun enfant réfugié n’ait été expulsé des écoles primaires ou secondaires publiques lorsque ses résultats scolaires le permettaient. Cependant, les réfugiés ne sont pas autorisés à poursuivre leurs études dans les universités publiques, contrairement aux citoyens.
Le Gouvernement de Malawi a fait des réserves concernant l’article 24 de la Convention de 1951 des Nations Unies relative aux réfugiés, qui met en lumière le droit à la législation du travail et au droit à la sécurité sociale. Des réfugiés ne sont pas autorisés à se faire enregistrer dans le travail et par conséquent n’ont pas droit à la sécurité sociale. Cependant, l’article 29 de la Constitution de Malawi consacre le droit de travail et de faire le commerce n’importe où à l’intérieur du pays. Des réfugiés au Malawi n’ont pas droit au mouvement ou à résider ailleurs que dans un camp désigné. Conséquemment, suivant ces limitations, des réfugiés ne peuvent pas travailler en dehors du camp ou faire des activités commerciales dans d’autres endroits sans crainte d’être sabotés par la police ou l’immigration.
L’article 34 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés porte sur la liberté de circulation et le choix de la résidence. L’article 13 de la Déclaration Universelle de Droits de l’Homme (1948) consacre le droit de circulation et de se choisir le lieu de résidence. L’article 39(1) de la Constitution de Malawi consacre le droit de mouvement. Le Gouvernement du Malawi a fait des réserves quant à ces droits et a indiqué que des réfugiés doivent résider dans un lieu désigné par l’autorité administrative. Les autorités d’immigration et de police ont profité de cette disposition et ont fait graves violations relatives à l’arrestation et à la détention de tout réfugié qui tente de quitter le camp sans autorisation.
Au Malawi, nul réfugié ne peut devenir citoyen. En vertu de la loi sur la registration nationale dans son article 9 personne ne peut être enregistré sauf des citoyens ou ceux qui possèdent la résidence permanente. Dans ce sens, des enfants nés des parents réfugiés ne peuvent être enregistrés dans les documents de la registration nationale, ils ne peuvent pas devenir citoyens par naissance. La loi sur la citoyenneté au Malawi dans article 3 et 4 stipule que la nationalité de Malawi est acquise par naissance si l’un des parents de l’enfant possède la nationalité de ce pays. Il est évident qu’aucun réfugié ne peut obtenir une carte d’identité ou un passeport.
- Les droits fondamentaux des réfugiés
- 3.1. Le principe de non-refoulement
Les conventions de 1951 et de 1967 stipulent clairement que les réfugiés ont le droit de demander l’asile dans n’importe quel pays et que, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire du pays qui a accepté de les accueillir, ils ne doivent pas être expulsés. Tout retour dans leur pays d’origine doit découler de leur volonté ; ils ne doivent pas être contraints de retourner dans l’État qu’ils ont fui. L’article 33(1) de la Convention de Genève stipule : « Aucun État contractant n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.» Cette loi interdit l’expulsion des réfugiés.
En mai 2025, la presse écrite du Malawi a annoncé que le gouvernement avait entrepris de négocier avec des pays concernés afin que les réfugiés soient renvoyés dans leurs États d’origine. Il a été expliqué que ce plan avait été mis en place suite à l’arrêt des aides américaines destinées aux réfugiés. Ce plan est contraire aux solutions durables préconisées par la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés pour atténuer des difficultés rencontrées par les réfugiés : (a) aider les réfugiés à résider et travailler dans des pays développés où ils peuvent acquérir la nationalité ; (b) accorder la nationalité aux réfugiés afin qu’ils puissent travailler comme citoyens et gagner leur vie sans dépendre de l’aide ; (c) aider les réfugiés souhaitant retourner volontairement dans leur pays d’origine à le faire. Ces trois propositions s’opposent à toute solution fondée sur le retour forcé.
- 3.2. Le droit à la nationalité
L’article 34 de la Convention de Genève traite de la naturalisation. Il stipule : « Les États contractants faciliteront, dans la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils mettront notamment tout en œuvre pour accélérer les procédures de naturalisation et réduire autant que possible les frais et les coûts de ces procédures. » Au Malawi, la loi de 1989 sur les réfugiés constitue une violation manifeste et grave de la dignité humaine des réfugiés, car elle porte atteinte à leur droit fondamental à la naturalisation. Au vu de cette loi, les réfugiés ne devraient pas acquérir la citoyenneté et, par conséquent, ne devraient pas acquérir de terres. La loi foncière de 2022 stipule que les étrangers ne devraient pas acquérir de terres au Malawi. Quiconque n’a pas de lieu pour cultiver ou construire sa propre maison est constamment sous pression pour payer son loyer et acheter de la nourriture. Par conséquent, lorsque ses revenus sont soudainement perturbés, toute la famille est plongée dans les larmes. Les réfugiés de Dzaleka n’ont aucun endroit pour acquérir la terre et vivent dans des maisons inadaptées. De ce fait, nombre d’entre eux sont entassés dans de petites maisons où vivent enfants et parents. Ce fait de vivre dans des maisons exiguës et inadaptées porte atteinte à la moralité des enfants, exposés aux rapports sexuels de leurs parents. Les réfugiés ne peuvent pas vivre comme des citoyens, car ils sont limités par la loi. Par exemple, les magasins des réfugiés ont été pillés et leurs conteneurs confisqués entre mai et août 2023 lors de l’opération dite de « déménagement forcé des réfugiés ». Cette violation de la propriété individuelle constitue une entorse grave et manifeste de la dignité humaine des réfugiés.
- 3.3. Droits de circulation et de résidence
La loi sur les réfugiés de 1989 stipule que les réfugiés doivent vivre dans un lieu désigné sans le quitter, sauf autorisation spéciale. Cet article traite des réfugiés comme des prisonniers, qui doivent être maintenus dans un lieu déterminé et soumis à un contrôle strict s’ils ne veulent pas être arrêtés en tentant de sortir du camp. Il s’agit d’une atteinte à leur droit de mouvement, car toute personne est libre de se déplacer selon sa volonté. La loi sur les réfugiés de 1989 restreint les déplacements des réfugiés et des demandeurs d’asile, les obligeant à rester dans un camp désigné.
La Déclaration universelle des droits de l’homme garantit la liberté de circulation dans son article 13. Cette disposition est confirmée par la Constitution du Malawi dans son article 39 (1). En vertu de cet article, toute personne est libre de circuler sur le territoire de l’État sauf si cette circulation peut perturber l’ordre du pays. L’article 26 de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (1951) consacre la liberté de circulation. Elle stipule : « Chaque État contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit de choisir leur lieu de résidence afin de circuler librement, sous réserve de toute réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances. » Il est important de noter que le droit de circulation signifie qu’une personne est libre d’établir sa résidence là où elle le souhaite sur le territoire de l’État. Conformément à ce droit, les réfugiés au Malawi devraient être autorisés à se déplacer à l’intérieur du pays sans restriction et à résider où ils le souhaitent, à condition de ne pas porter atteinte aux droits d’autrui.
L’article 28 (1) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (1951) concerne les documents de voyage : « Les États contractants délivreront aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire des documents de voyage leur permettant de voyager hors de leur territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, et les dispositions de l’annexe à la présente Convention s’appliqueront à ces documents.» Le droit de circulation comprend le droit de voyager hors du pays et d’y revenir. Dans ce contexte, la République du Malawi devrait délivrer des documents de voyage ou des passeports leur permettant de quitter le pays dès qu’ils ont des raisons de le faire. Avant et après l’opération de déménagement forcée de 2023, de nombreux réfugiés ont été arrêtés et détenus simplement parce qu’ils avaient quitté le camp de réfugiés de Dzaleka sans l’autorisation du responsable du camp. Dans certains cas, ces réfugiés cherchaient de la nourriture et d’autres moyens de subsistance. Il est donc clair que la dignité humaine des réfugiés est gravement bafouée au Malawi.
En 2006 et 2022, suite aux plaintes déposées par les réfugiés, les juges ont réitéré le rejet de leurs demandes et leur ont recommandé de quitter des zones urbaines pour se rendre au camp de Dzaleka. Cette décision a été suivie d’une opération violente qui s’est traduite en actes brutaux : arrestations de réfugiés, détention à la prison de haute sécurité de Maula, viols de femmes, brutalités envers des enfants et pillage de leurs commerces. Le Ministre de la Sécurité intérieure, Monsieur Zikhale Ngoma, était le responsable de l’opération qui encourageait la police et les agents de l’immigration à poursuivre leurs activités de chasse aux réfugiés. La communauté internationale a critiqué cette opération. À ce jour, aucune poursuite judiciaire n’a été engagée pour ces activités criminelles.
- 3.4. Droit de propriété
Selon l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, toute personne a droit à la propriété, individuellement ou collectivement. Cet article est repris dans la Constitution du Malawi. La Convention des Nations Unies stipule à l’article 13 ce qui suit concernant les biens meubles et immeubles : « Les États contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible et, en tout état de cause, non moins favorable que celui accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances, en ce qui concerne l’acquisition de biens meubles et immeubles et autres droits y afférents, ainsi que les baux et autres contrats portant sur des biens meubles et immeubles.» Les réfugiés ne sont pas autorisés à acheter des terres au Malawi en vertu de la loi foncière promulguée en 2022. L’amendement devrait préciser que les réfugiés sont autorisés à posséder des biens.
- 3.5. Droit à la sécurité (droit au rapatriement non forcé)
Au Malawi, la loi sur des réfugié dans son article 10 stipule que la loi sur des réfugiés ne doivent pas être expulsés sauf en cas de crimes graves. Cet article consacre le principe de non-refoulement. Si un réfugié fait face à un procès pouvant entraîner une extradition, il doit être expulsé vers son pays d’origine si toutes les voies de recours ont été épuisées. L’amendement d cette loi devrait clairement indiquer que les réfugiés ne doivent pas être expulsés s’il existe des raisons convaincantes de penser qu’ils seront persécutés dans le pays qui les accueille. L’amendement devrait impliquer que les réfugiés ou les demandeurs d’asile ne doivent pas être soumis à des arrestations arbitraires, à la détention, à la torture ou à toute autre persécution en raison de leur statut social de réfugié par certaines autorités de sécurité. Il faut préciser dans l’amendement que nul ne sera arrêté simplement parce qu’il se présente aux frontières du Malawi en tant que demandeur d’asile, comme le stipule l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le droit à la sécurité implique que les réfugiés ne doivent pas être soumis à une discrimination fondée sur la xénophobie. Dans ce contexte, l’amendement de la loi devrait clarifier que les réfugiés doivent être protégés contre tout acte de discrimination ou de xénophobie. La sécurité des réfugiés doit inclure leurs biens. Par conséquent, compte tenu du droit à la sécurité, l’amendement devrait préciser que les biens des réfugiés doivent être strictement protégés. Le droit à la sécurité implique le droit à la vie. Dans ce contexte, le droit à la vie des réfugiés doit être garanti par l’amendement, tel qu’il est inscrit dans la Constitution.
- 3.6. Le droit au travail
La loi de 1989 sur les réfugiés restreint le droit au travail des réfugiés et des demandeurs d’asile. L’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule que toute personne a le droit de travailler dans de bonnes conditions d’emploi. La Convention des Nations Unies relative aux réfugiés (1951) stipule à l’article 17 (1) : « Les États contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d’un pays étranger se trouvant dans les mêmes circonstances, en ce qui concerne le droit d’exercer une activité salariée. » Ces deux textes juridiques internationaux s’opposent clairement au chômage des réfugiés, qui pourrait être motivé par des décisions politiques. Ainsi, l’amendement de la loi de 1989 sur les réfugiés devrait permettre aux réfugiés et aux demandeurs d’asile de travailler conformément à cette disposition. Les réfugiés ne doivent pas être discriminés en matière d’emploi dans le pays ; la délivrance de permis de travail doit être supprimée afin que les réfugiés puissent travailler où ils le souhaitent au Malawi.
- 3.7. Le droit aux besoins fondamentaux
Les besoins fondamentaux de tout être humain sont : la nourriture, l’eau, un logement, des vêtements, l’hygiène, les soins médicaux, etc. Ces besoins fondamentaux symbolisent la dignité humaine. La dignité humaine signifie que l’homme doit bénéficier d’un niveau de vie lui garantissant certains besoins fondamentaux. Dans de nombreux cas et dans de nombreux pays, ces besoins fondamentaux sont satisfaits par le travail. Le travail constitue donc une caractéristique fondamentale de la personne humaine. Le pape Jean-Paul II a écrit une encyclique intitulée « Sur le travail » dans laquelle il a souligné que l’homme est intrinsèquement caractérisé par le travail, car c’est par son travail qu’il gouverne le monde. Les réfugiés au Malawi ne sont pas autorisés à travailler et sont donc condamnés à mendier leur pain quotidien auprès de leurs amis vivant en Europe ou à souffrir de la faim, car le PAM (Programme alimentaire mondial) verse chaque mois environ 4 dollars américains à chaque personne. Les réfugiés meurent de faim, car ils ne sont pas autorisés à travailler pour subvenir aux besoins fondamentaux de leur famille. Dans ce contexte, certaines femmes sont contraintes de vendre leur corps pour survivre. Ces conditions de vie sont simplement dues au fait que les réfugiés sont détenus dans le camp comme des prisonniers, tandis que certains d’entre eux sont des experts professionnels pouvant être employés dans les secteurs de l’éducation ou de la santé.
La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (1951) stipule à l’article 18 : « Les États contractants accorderont à tout réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, en tout état de cause, un traitement non moins favorable que celui accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances, en ce qui concerne le droit de se livrer à l’agriculture, à l’industrie, à l’artisanat et au commerce, et de créer des sociétés commerciales et industrielles. » La loi sur les réfugiés de 1989 restreint l’exercice d’une activité indépendante par les réfugiés et les demandeurs d’asile pour subvenir à leurs besoins. Aux termes de cette loi, la dignité humaine des réfugiés est compromise au point qu’ils sont condamnés à mourir de faim ou à agir contrairement à leur nature humaine en mendiant ou en se livrant à des activités sexuelles. On constate qu’en raison de ces restrictions, de nombreux jeunes sans emploi sont contraints de passer leurs journées à consommer de la drogue ou à tenter de gagner leur vie en fuyant les camps pour faire la prostitution dans la ville de Lilongwe. Privé du droit au travail, une personne peut se retrouver dans une situation difficile et se tourner vers des activités criminelles comme le vol ou le commerce sexuel pour survivre.
- 3.8. Le droit à la sécurité sociale
Dans tous les pays développés, les personnes âgées vivent de leur pension mensuelle. Au Malawi, les réfugiés ne sont pas autorisés à travailler et, par conséquent, ils ne contribuent pas aux fonds sociaux nationaux. Lorsqu’ils atteignent l’âge où ils ne peuvent même plus aller mendier, ils sont condamnés à une mort atroce. Tel est le sort de nos vieux réfugiés, condamnés à mourir dans de terribles conditions, car même leurs enfants, censés prendre soin d’eux, sont sans emploi. Le gouvernement du Malawi a réservé le droit au travail et, par conséquent, le droit à la sécurité sociale des réfugiés comme nous l’avons mentionné ici-haut.
3.9. Droit à l’éducation
La loi sur les réfugiés de 1989 restreint le droit des réfugiés à l’éducation. L’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule que toute personne a droit à l’éducation élémentaire. La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (1951), dans son article 22 (1), stipule : « Les États contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu’à leurs nationaux en ce qui concerne l’enseignement élémentaire.» Ainsi, les réfugiés ont le droit de fréquenter l’école publique sans restriction. Les enfants de réfugiés sont privés de la possibilité de fréquenter l’école publique et d’accéder à l’université, même si leurs résultats scolaires sont excellents. Ils sont victimes de discrimination. Cette discrimination témoigne clairement de l’ignorance des réfugiés au Malawi, car sans formation universitaire, ils sont maintenus dans la pauvreté et subissent d’autres obstacles qui les empêchent de s’émanciper. Les enfants de réfugiés ne peuvent pas fréquenter les universités publiques. Dans notre société actuelle, sans diplôme d’une université reconnue, il est très difficile d’obtenir un bon emploi dans le secteur formel. La dignité humaine est intimement liée à l’éducation. L’éducation est une caractéristique essentielle de l’homme. Maintenu dans l’ignorance, un individu est privé de sa connaissance essentielle. L’être humain est créé à l’image de Dieu afin d’améliorer sa capacité à connaître et à œuvrer pour un monde meilleur. Les réfugiés n’ont pas le droit d’étudier et doivent rester dans le camp où on leur propose une éducation qui les empêche de rivaliser avec les autres sur le marché international de l’emploi. Ainsi, l’accès au savoir est restreint et, par conséquent, l’accès à des emplois améliorés leur permettant de maintenir leurs conditions de vie est limité.
3.10. Le droit aux soins de santé
Lorsqu’un réfugié est malade, la procédure d’admission dans les hôpitaux publics est draconienne. Certains réfugiés décèdent avant d’obtenir les documents de voyage nécessaires pour se faire soigner à l’étranger, tandis que d’autres meurent en attendant l’autorisation d’être soignés dans les hôpitaux publics. Dans le camp de réfugiés de Dzaleka, l’hygiène pose un sérieux problème en raison du manque de latrines adéquates ; le manque d’eau dans le camp aggrave encore les problèmes d’hygiène. Les problèmes d’hygiène aggravent le risque de contamination par de nombreuses maladies, comme la diarrhée et d’autres maladies transmissibles. Ils témoignent de la profonde atteinte à la dignité humaine des réfugiés dans le camp de Dzaleka. La surpopulation du camp, qui abrite plus de 90 000 personnes alors qu’il ne devrait en accueillir que 12 000, laisse présager une situation durable. Le droit universel aux soins médicaux est bafoué au Malawi pour des réfugiés, car ces réfugiés doivent suivre une procédure qui peut nuire à leur santé en cas de retard dans l’accès aux soins. Les réfugiés devraient pouvoir bénéficier du droit d’être soignés dans les hôpitaux et autres établissements médicaux publics sans difficulté. Ils devraient également avoir accès aux services de santé publics.
- Conclusion et recommandation
Les droits fondamentaux des réfugiés sont gravement et manifestement compromis au Malawi. La solution est loin d’être trouvée sans une modification de la loi sur les réfugiés (1989). Cela signifie que la violation de la dignité humaine des réfugiés au Malawi repose uniquement sur une loi injuste qui ne tient absolument pas compte des droits fondamentaux des réfugiés. De cette façon, les réfugiés sont traités comme de simples objets non respectés. Ils n’ont aucun droit à revendiquer, même s’ils sont pillés ou arrêtés en raison de leur présence hors du camp. Les réfugiés du Malawi appellent la communauté internationale à intervenir afin que leurs droits fondamentaux soient respectés et protégés. En d’autres termes, ils sont considérés comme des prisonniers ou des esclaves et condamnés à mourir de faim ou des autres mauvais traitements qui pourraient leur être infligés en raison de leurs conditions de vie inacceptables dans le camp de Dzaleka qui surpeuplé. La solution meilleure est l’amendement de la loi sur des réfugiés de 1989 et suppression des réserves que le Malawi a fait en ratifiant les conventions sur des réfugiés des UN de 1951 et de 1967. Dans ce contexte, des réfugiés pour circuler librement et se choisir un lieu de résidence qui peut leur permettre de travailler pour gagner la vie sur le territoire de pays.
Athanase Dushimirimana
16/11/2025
Vous pourriez être intéressé(e)

Tanzanie : le coup raté contre Samia Suluhu Hassan et l’échec du projet d’« Empire Hima-Tutsi »
Emmanuel Neretse - 8 novembre 2025Une élection qui déjoue les plans d’un empire régional L’élection présidentielle du 29 octobre 2025 en Tanzanie a marqué un tournant majeur dans la politique de…
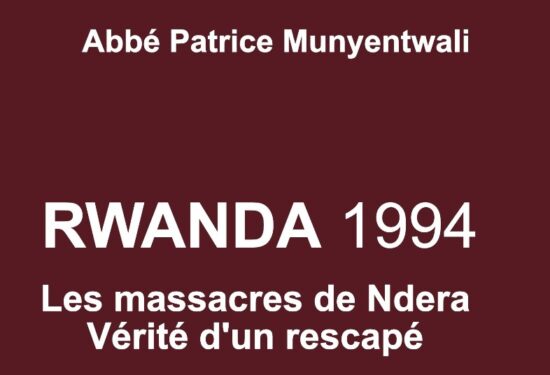
Vient de paraître : Rwanda 1994. Les massacres de Ndera – Vérité d’un rescapé
Gaspard Musabyimana - 3 novembre 2025Rwanda 1994. Les massacres de Ndera – Vérité d’un rescapé Abbé Patrice Munyentwali – Éditions Scribe Et si l’un des témoins directs du drame rwandais de 1994…

Casques bleus ou bras armé de Kigali ? Les ambiguïtés du déploiement rwandais en Centrafrique
Emmanuel Neretse - 2 novembre 2025Entre missions onusiennes et accords bilatéraux, plus de 5 000 soldats rwandais agissent en Centrafrique sous un double mandat opaque. À la veille du renouvellement du mandat…
Les plus populaires de cette catégorie


Hutu et Tutsi en R.D. Congo: la facture de la fracture à l’aune du passé
Mbumburwanze Shamba Nzapfakumunsi - 29 octobre 2025
Après la RDC, le Burundi menacé : le spectre de Kagame plane sur Bujumbura
Emmanuel Neretse - 29 octobre 2025












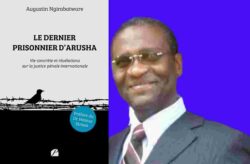
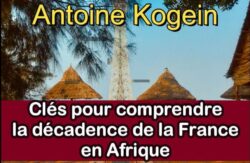





![Paul Kagame a fait main basse sur le commerce juteux de la friperie et sur la culture et la vente du cannabis [Série 8]](http://www.echosdafrique.com/wp-content/uploads/2021/07/cannabis-Kagme_Marijuana-250x161.jpg)