Accords de Washington et de Doha : Paix historique ou capitulation annoncée ?
Entre retrait ambigu des forces rwandaises, intégration politique du M23/AFC et risque de balkanisation, la RDC joue son avenir dans un accord où la souveraineté nationale semble plus négociée que garantie.
L’évolution du conflit à l’Est de la RDC : Origines et dynamique actuelle
Le conflit qui ravage l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC) trouve ses racines dans les événements de 1996. À cette époque, les troupes de l’armée de Paul Kagame, fraîchement victorieuses au Rwanda, ont franchi la frontière congolaise pour envahir les provinces du Nord et du Sud Kivu.
Officiellement, leur intervention visait à poursuivre et neutraliser ceux qu’ils qualifiaient de « génocidaires », mais il s’agissait en réalité de millions de réfugiés Hutu ayant fui le Rwanda et se retrouvant massés dans des camps précaires autour des villes de Goma et Bukavu.
Depuis cette incursion, les troupes rwandaises n’ont jamais véritablement quitté le territoire congolais, poursuivant au contraire leurs opérations sous différentes formes et prétextes.
Un tournant décisif s’est produit à partir de 2022, lorsque la conflictualité dans la région a atteint une intensité inédite, accompagnée de conséquences humanitaires majeures. Dans une sorte de « guerre éclair », les forces dirigées par Paul Kagame ont rapidement conquis l’essentiel des provinces du Nord et du Sud Kivu, incluant leurs chefs-lieux emblématiques, Goma et Bukavu. L’impact sur les populations locales s’est traduit par une aggravation dramatique de la crise humanitaire.
Afin de brouiller les pistes et de masquer la responsabilité du régime rwandais dans cette situation, Paul Kagame a procédé à une reconfiguration de ses troupes d’occupation en groupes armés désignés sous les noms AFC/M23. Ces entités se sont dotées, au moins officiellement, de dirigeants congolais, ce qui permet aux troupes rwandaises d’opérer sous la bannière des AFC/M23 tout en consolidant leur contrôle sur les territoires conquis. Dans ces zones, une administration parallèle a été instaurée, créant ainsi une véritable situation d’« État dans l’État » et poursuivant l’élargissement des territoires sous domination rwandaise.
Ce contexte révèle l’existence d’une guerre ouverte et meurtrière entre le Rwanda et la RDC. L’extension continue du conflit menace non seulement la stabilité de la RDC, mais expose également l’ensemble de la région des Grands Lacs à des risques d’embrasement, de balkanisation ou de chaotisation du pays, avec des conséquences prévisibles d’une gravité extrême.
Les principaux points des accords de paix : Washington et Doha
À son retour à la Maison-Blanche, le président Donald Trump a fait de la résolution du conflit opposant le Rwanda à la République Démocratique du Congo (RDC) l’une de ses priorités pour le continent africain. Se positionnant en médiateur, il convie les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi à Washington, lançant ainsi le « processus de Washington » placé sous l’égide et la garantie des États-Unis. Ce processus aboutit à la signature d’un accord de paix entre les deux pays, le 27 juin 2025, à Washington. Toutefois, cet accord prévoit plusieurs étapes avant d’aboutir à une paix durable, qui reste encore à concrétiser, en particulier à l’Est de la RDC, toujours en proie à l’agression du Rwanda.
L’accord signé repose sur deux axes principaux : un volet sécuritaire et un volet politico-économique. Concernant l’aspect sécuritaire et politique, le processus de Washington répartit les engagements entre les deux parties. Du côté rwandais, Paul Kagame est appelé à retirer ses troupes de la RDC. Cependant, il refuse d’employer ce terme, préférant l’expression plus floue de « levée des mesures de son dispositif défensif », sans préciser la nature exacte de ce dispositif ni sa localisation, que ce soit sur le territoire congolais ou au Rwanda. Pour sa part, la RDC doit s’engager à « neutraliser et éradiquer les FDLR de RDC ».
D’autres aspects liés à l’aspect sécuritaire et politique, tels que le retrait des groupes AFC/M23 des zones occupées, la question de leur avenir, ainsi que la restauration de l’autorité de l’État dans ces régions, sont confiés au processus de Doha. C’est ainsi qu’à Doha, après trois mois de discussions menées sous l’égide du Qatar, le gouvernement de la RDC et le mouvement AFC/M23 signent et rendent publique, le 17 juillet 2025, la « Déclaration de principes de Doha ». Ce document marque une étape dans la négociation mais ne constitue pas encore un accord définitif ; il prépare la voie vers la conclusion future d’un accord-cadre.
Parallèlement, dans le cadre du mécanisme de vérification de l’accord de Washington du 27 juin 2025 et sous la supervision des États-Unis, la RDC et le Rwanda paraphent, le 8 novembre 2025 à Washington, un Accord d’Intégration Économique Régionale. L’objectif affiché est de renforcer la coopération entre les deux États dans les secteurs miniers, énergétiques et des infrastructures.
Dans la foulée de cet accord économique signé à Washington entre la RDC et le Rwanda et à travers lequel tous les analystes voient une rémunération au Rwanda ou un pot-de-vin pour qu’il cesse d’envahir la RDC, le 08 Novembre 2025 fut annoncé un Accord dans le cadre du Processus de Doha entre le Gouvernement de la RDC et l’AFC / M23 qui devrait être signé le 11 Novembre. Mais à la fin de cette journée il a été annoncé que l’accord serait signé très prochainement même si aucune date n’était avancée.
Le 14 novembre cependant, les observateurs ont souligné que la médiation du Qatar s’affairait toujours pour obtenir le plus rapidement possible la signature d’un accord de paix entre le gouvernement congolais et le groupe AFC/M23.
Finalement, le samedi 15 novembre 2025, les deux parties ont paraphé l’accord-cadre de paix qui constitue l’une des étapes avant la signature d’un accord final. En effet ce qui a été signé à Doha le 15 novembre n’est pas encore l’accord de paix définitif, mais il s’agit d’une étape vers celui-ci. Ainsi le président étasunien aura imposé cette paix de « papier », ou « d’autosatisfecit », comme le qualifient certains car cette paix est et reste toujours introuvable dans les deux Kivu notamment à Goma et à Bukavu accolées au Rwanda de Paul Kagame.
L’accord-cadre de Doha : Un jalon décisif vers une paix sous condition
L’accord-cadre de Doha constitue une étape clé dans le processus de résolution du conflit opposant la République Démocratique du Congo (RDC) au Rwanda, en intégrant et en préparant la mise en application de l’accord définitif de Washington, qui devrait prochainement être signé par les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame, sous l’égide de Donald Trump. Cet accord, loin de se limiter à une simple cessation des hostilités, marque un tournant majeur, non seulement pour la sécurité de la RDC, mais également pour l’équilibre géopolitique de toute la région des Grands Lacs. Il s’inscrit dans la continuité d’un conflit qui dure depuis trois décennies et remet en question la souveraineté de la RDC en tant qu’État unifié, tout en consacrant le rôle central que le Rwanda de Paul Kagame entend jouer dans la région.
Il convient de souligner que le texte signé à Doha n’est pas encore un accord final. Il s’agit d’un document structurant qui organise la poursuite du dialogue après plusieurs séries de pourparlers et des engagements antérieurs qui n’ont été que partiellement appliqués.
Par nature, cet accord-cadre définit la méthodologie, les protocoles et le calendrier des négociations qui devraient aboutir, dans les semaines à venir, à un accord de paix global. Le document signé à Doha le 15 novembre 2025 encadre ainsi la suite des négociations autour de huit protocoles, formulés en termes politico-diplomatiques : l’accès humanitaire, les arrangements sécuritaires et le DDR (désarmement, démobilisation, réinsertion), la restauration de l’autorité de l’État, le retour des déplacés et réfugiés, la relance économique, la justice transitionnelle, la lutte contre la discrimination et le renforcement de l’unité nationale.
D’un point de vue pratique, ces axes sont condensés en six points principaux qui font l’objet d’une énumération détaillée dans la suite du document. Le cadre signé à Doha organise donc les discussions futures, en précisant les thèmes à aborder, les acteurs concernés et le calendrier de mise en œuvre. Les protocoles sont conçus comme des chapitres à développer et à négocier séparément. Il est important de noter que l’accord-cadre n’entraîne pas d’engagement contraignant immédiat. Toutefois, s’agissant de la RDC, il apparaît que la plupart des exigences du Rwanda et du M23/AFC ont été acceptées, comme cela ressort explicitement de chacun des six points énumérés.
Dans la partie suivante, seront cités et analysés les termes de l’accord concernant chacun de ces points majeurs, en explicitant, selon notre opinion, ce que chaque point implique respectivement pour le Rwanda, la RDC et le M23/AFC.
Les six axes majeurs de l’accord-cadre de Doha
L’accord-cadre de Doha, signé entre le gouvernement de la RDC et le groupe armé AFC/M23 soutenu par le Rwanda, s’articule autour de six points essentiels qui structurent les engagements de chaque partie et illustrent les réalités nouvelles imposées par ce processus. Chacun de ces axes marque une inflexion significative dans la gouvernance, la sécurité et la souveraineté de la RDC.
1. Maintien intégral de la Constitution actuelle
La première clause stipule le maintien sans révision de la Constitution de la RDC jusqu’aux prochaines élections nationales. Pour la RDC, cela traduit une transition implicite, où les institutions légales et démocratiques, notamment le Parlement (Assemblée nationale et Sénat), se retrouvent paralysées et incapables de prendre des décisions relatives à la gouvernance. Le gouvernement en place se limite à la gestion des affaires courantes, sans marge d’initiative.
Du côté de l’AFC/M23, cette disposition consacre la prise de contrôle politique réelle du pays par le groupe armé et ses soutiens durant cette phase de transition, alors que la destination finale demeure incertaine.
Pour le Rwanda, Paul Kagame se positionne en spectateur, tout en gardant la main sur la situation en RDC qu’il influence depuis trois décennies, grâce à ses relais au sein de l’AFC/M23.
2. Organisation d’élections générales en 2028 sous supervision tripartite
Le deuxième point prévoit l’organisation d’élections générales en 2028, placées sous la supervision d’une commission électorale réformée et cogérée par des représentants du gouvernement, de l’opposition et de l’AFC/M23, à l’instar de la Cour Constitutionnelle qui devra valider les résultats.
Cette disposition, pour la RDC, l’AFC/M23 et le Rwanda, signifie que malgré la mise à l’écart des institutions républicaines, le M23/AFC a obtenu de réorganiser certaines structures selon ses propres exigences. Le gouvernement se retire, laissant la gestion du processus électoral au M23/AFC, et donc, indirectement, à Paul Kagame.
3. Engagement du président Félix Tshisekedi à ne pas briguer un nouveau mandat
Le troisième point engage le président Félix Tshisekedi à renoncer à tout nouveau mandat, dans le but de favoriser une alternance pacifique et d’apaiser les tensions internes. Même si la Constitution de la RDC interdit déjà à Tshisekedi de briguer un nouveau mandat, la demande émanant de l’AFC/M23, qui a également exigé le maintien de la Constitution, illustre une acceptation totale par le gouvernement congolais des exigences du groupe armé.
Pour le Rwanda, cette clause sert d’avertissement aux politiciens congolais : nul ne peut prétendre au pouvoir ou espérer s’y maintenir sans l’aval de Paul Kagame et du FPR.
4. Intégration graduelle des combattants de l’AFC-M23 au sein des FARDC
Ce quatrième point prévoit l’intégration progressive des combattants AFC-M23 dans l’armée nationale (FARDC) dans le cadre d’un programme DDR (Désarmement, Démobilisation, Réinsertion).
Pour la RDC, c’est un retour aux pratiques de mixage et brassage des groupes armés, qui avaient déjà montré leurs limites et abouti à une armée nationale éclatée et peu efficace.
Côté AFC/M23, il s’agit d’une victoire politique et militaire, leur permettant de contrôler deux provinces et de renforcer leur influence au sein des forces armées via ces processus d’intégration.
Pour le Rwanda, cette clause officialise l’infiltration des FARDC par ses réseaux, notamment au sein du haut commandement, avec l’installation d’officiers tutsi (rwandais ou congolais) selon la volonté de Paul Kagame, maintenant ainsi la vulnérabilité et l’inefficacité de l’armée congolaise.
5. Mise en place d’un mécanisme de cogestion administrative et sécuritaire
Le cinquième point prévoit la cogestion administrative et sécuritaire dans certaines zones du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, le temps de restaurer la confiance entre les communautés locales. Le dernier projet de texte sur la restauration de l’autorité de l’État évoquait une reprise progressive et coordonnée des institutions publiques, de la sécurité et des services essentiels.
Pour la RDC, cette disposition officialise la perte de souveraineté sur les territoires occupés par les troupes de Paul Kagame via le M23/AFC, et acte le fait accompli tout en cherchant à contenir la frustration des nationalistes face à cette situation.
Pour l’AFC/M23, c’est un encouragement à consolider l’administration parallèle qu’il met en place dans les domaines clés, créant ainsi un État de fait dans l’État.
Enfin, pour le Rwanda, ce point permet à Paul Kagame de retarder le retrait de ses troupes, tout en prétendant respecter les exigences internationales, notamment la résolution 2773 du Conseil de Sécurité de l’ONU, sans pour autant effectuer de retrait effectif.
6. Amnistie conditionnelle pour certains cadres du mouvement
Le dernier point accorde une amnistie conditionnelle à certains cadres politiques et militaires de l’AFC/M23, à l’exception de ceux impliqués dans des crimes de guerre ou des violations graves des droits humains.
Pour la RDC, cette clause entérine le partage du pouvoir avec les chefs rebelles, même condamnés par la justice, qui seront amnistiés, tandis que les commanditaires de crimes de guerre échappent à toute poursuite.
L’AFC/M23 bénéficie ainsi d’une impunité garantie, tant devant la justice congolaise qu’internationale, à l’image de leur chef Paul Kagame, qui jouit de la même protection depuis des décennies.
Intégration de l’accord de Doha dans le processus de Washington
L’accord de Doha, une fois les protocoles d’application négociés, est destiné à être intégré dans l’accord global de Washington. Or, la réunion de Washington prévue pour le 13 novembre en vue de la signature finale entre la RDC et le Rwanda, incluant l’accord de Doha, a été reportée indéfiniment. À ce jour, la date à laquelle Donald Trump convoquera Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour apposer leurs signatures reste inconnue.
Conclusion : marges de manœuvre et leçons pour la RDC
Face aux pressions internationales, le gouvernement de Kinshasa ne semble pouvoir résister. Cependant, il pourrait attirer l’attention mondiale sur les incohérences et injustices de ces accords, en retardant la signature tant que le retrait des troupes rwandaises, l’activation du mécanisme de vérification et le respect des engagements humanitaires et sécuritaires ne sont pas constatés. Sans ces garanties, la signature à Washington risquerait d’être purement symbolique.
La restauration de l’autorité de l’État sur l’ensemble des territoires occupés devrait être une condition préalable à toute avancée en matière de sécurité, d’aide humanitaire ou de relance économique. Cette crise impose à la RDC, mais aussi aux autres régimes de la région et d’Afrique subsaharienne, de tirer les leçons d’une guerre imposée par un pays voisin. En l’absence de puissance militaire, ni la justice ni la diplomatie ne suffisent à faire entendre sa voix. Dans la géopolitique régionale, seule la force compte.
Enfin, le malheur de la RDC ne réside pas seulement dans ses immenses ressources naturelles, mais également dans l’influence persistante de Paul Kagame. Il est essentiel d’anticiper l’après-Kagame pour éviter la répétition de ce schéma, notamment par des politiciens congolais qui pourraient poursuivre son œuvre en RDC.
Emmanuel Neretse
Vous pourriez être intéressé(e)
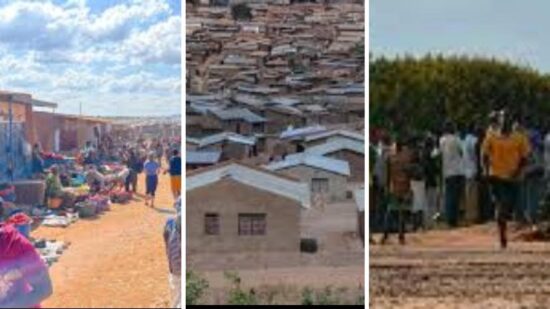
La dérogation aux droits fondamentaux des réfugiés au Malawi
Athanase Dushimirimana - 16 novembre 2025Documents juridiques internationaux consacrés aux droits des réfugiés La Seconde Guerre Mondiale a poussé d'innombrables personnes à quitter leurs pays pour s'établir à l'étranger. Dès lors,…

Tanzanie : le coup raté contre Samia Suluhu Hassan et l’échec du projet d’« Empire Hima-Tutsi »
Emmanuel Neretse - 8 novembre 2025Une élection qui déjoue les plans d’un empire régional L’élection présidentielle du 29 octobre 2025 en Tanzanie a marqué un tournant majeur dans la politique de…
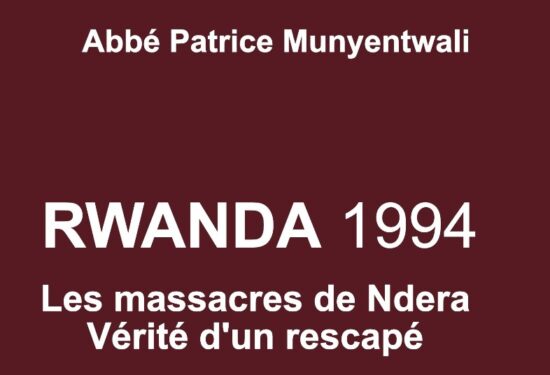
Vient de paraître : Rwanda 1994. Les massacres de Ndera – Vérité d’un rescapé
Gaspard Musabyimana - 3 novembre 2025Rwanda 1994. Les massacres de Ndera – Vérité d’un rescapé Abbé Patrice Munyentwali – Éditions Scribe Et si l’un des témoins directs du drame rwandais de 1994…
Les plus populaires de cette catégorie

Casques bleus ou bras armé de Kigali ? Les ambiguïtés du déploiement rwandais en Centrafrique
Emmanuel Neretse - 2 novembre 2025

Hutu et Tutsi en R.D. Congo: la facture de la fracture à l’aune du passé
Mbumburwanze Shamba Nzapfakumunsi - 29 octobre 2025












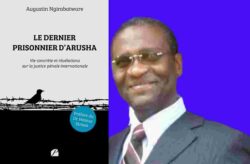
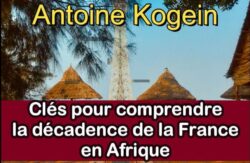





![Paul Kagame a fait main basse sur le commerce juteux de la friperie et sur la culture et la vente du cannabis [Série 8]](http://www.echosdafrique.com/wp-content/uploads/2021/07/cannabis-Kagme_Marijuana-250x161.jpg)













